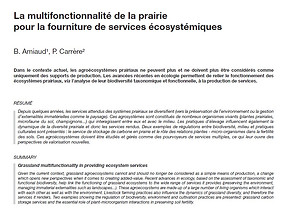AGRICULTURE ET SYLVICULTURE INTENSIVES
Petite Beauce proche de Blois [Loir-et-Cher] © Yann Batailhou
Notre avenir est très incertain !
Si l’on considère qu’un territoire est essentiellement composé de milieux urbains, agricoles et forestiers, que se passe-t-il si l’urbanisation s’étend davantage (cf. STOP À L’URBANISATION), que les espaces agricoles s’intensifient toujours plus et que la forêt s’uniformise ? À quoi ressemblent nos paysages à l’heure où nous en sommes tous à vouloir nous développer d’une seule et même façon ? Et que restera-t-il de biodiversité et de fonctions écologiques dans les étendues désertiques créées par l’homme ?
Nous voulons consommer et rentabiliser à outrance le moindre m² de terrain. À tel point que lorsqu’on jalonne la France, ont peut-être souvent témoin du spectacle de désolation que représentent les openfields et, tant bien même serions-nous dans une région d’élevage que nous serions en présence de pâturages arasés tant la quantité d’animaux à l’hectare va au-delà de la capacité d’accueil alimentaire d’une prairie.
Et que dire de nos forêts, toutes gérées selon une méthode non durable car victime d’une vision étriquée de certains forestiers dont le seul but est de générer du bois, encore du bois, toujours du bois !
Le no futur de l’agriculture…
Qui dit agriculture intensive sous-entend plusieurs facteurs qui mis bout à bout appauvrissent la biodiversité, avec une diminution globale des peuplements floristiques et faunistiques, et qui remettent en cause les multiples fonctions des écosystèmes agropastoraux (apport fourrager, plantes médicinales, régulations biologiques, purification des eaux, prévention des crues, séquestration du carbone, stabilité des sols …). Ces principaux facteurs sont les suivants :
-
Utilisation importante de pesticides, qui diminuent l’abondance globale en invertébrés et en espèces végétales, notamment rudérales ;
-
Transformation des prairies : le retournement de ces milieux, pour laisser place aux cultures, détruit l’entomofaune du sol ainsi que la diversité floristique avec un impact significatif sur leur abondance ;
-
L’arrachage des haies, consécutif à l’augmentation de la taille des parcelles (remembrement …) pour faciliter le travail de la terre, induit une élimination de refuges pour la faune ainsi qu’une perte des fonctionnalités associées à ces habitats (infiltration des eaux dans le sol, brise-vents, corridors écologiques …) ;
-
L’introduction de nouvelles variétés de céréales plus denses (avec plus de tiges par pied) ainsi que le surpâturage s’accompagnent d’une perte de zone de reproduction pour les oiseaux (inaccessibilité des parcelles, piétinements …) et laissent peu de place à la flore sauvage ;
-
Les pâtures accueillent trop d’unité de bétail à l’hectare et les oiseaux qui construisent leur nid au sol souffrent de ces densités et du piétinement plus intense qu’elles induisent ;
-
Le développement des oléoprotéagineux (Tournesol, Colza …) entraîne une modification des techniques agricoles avec, notamment, l’abandon des céréales de printemps remplacées par les céréales d’hiver : auparavant, l’agriculteur semait ses céréales au printemps et laissait le sol se « reposait » pendant tout l’hiver au profit de la flore sauvage qui servait de nourriture aux oiseaux, entre autres. Désormais, les oléoprotéagineux sont cultivés au printemps et les céréales en hiver, augmentant ainsi le rendement des parcelles avec un appauvrissement des sols, l’utilisation permanente de pesticides et moins de nourriture disponible pour la faune, et surtout les oiseaux granivores (25 % d’oiseaux en moins en 20 ans pour la France dans nos plaines agricoles).


Photos ci-dessus: dans la Sarthe en haut à gauche,« Dans cette parcelle de Colza, j'agis pour protéger les abeilles !» (rien n'est moins sûr quand on connaît l'itinéraire technique adopté par l'agriculteur), et dans le Loir-et-Cher, "Votre alimentation commence ici" (peut-être à l'endroit même où s'arrête notre santé!)... Quand l'agriculture est en pleine crise démagogique © Yann Batailhou
Un des indicateurs biologiques le plus sensible à la destruction des milieux naturels est certainement celui des papillons de jour (l’Office pour les insectes et leur environnement estime que, dans certains départements français, 2 espèces de papillons de jour sur 3 ont déjà disparus). Les causes de ce déclin majeur est lié au drainage des milieux naturels humides (ayant pour fonction l’utilisation des terres à des fins agricoles) et la conversion d’espaces naturels en terres agricoles utilisées intensivement.
A contrario, l’abandon des terres agricoles (et notamment de l’élevage) conduit dans une grande partie du territoire français à une fermeture des milieux (évolution d’un stade herbacé vers un stade forestier). Or, ce sont les milieux prairiaux (prairies calcicoles notamment) ou les landes qui sont les plus riches en flore et en papillons.
Bref, en d’autres termes, d’un côté on abandonne l’élevage extensif et, de l’autre, on privilégie une agriculture intensive qui dépeuple et uniformise nos champs et qui a des impacts sur la santé publique.
… et de la sylviculture
Tout comme l’agriculture intensive, la sylviculture intensive vise à maximiser la production. Pour rentabiliser chaque parcelle forestière, trois techniques sont utilisées :
-
La plantation d’espèces d’arbres à croissance rapide au dépend de nos espèces d’arbres indigènes, et donc au détriment de la diversité des milieux forestiers ;
-
L’utilisation de fertilisants et de pesticides ;
-
Le recourt à des coupes rases régulières pour favoriser la croissance des arbres.
On peut s’émerveiller des forêts de sapins et d’épicéas en montagne, là où leurs stations naturelles sont souvent mixtes, soit accompagnées d’espèces de feuillues. Mais en plaine, la réalisation de monocultures denses d’essences, qui ne pousseraient pas spontanément si l’homme ne s’en mêlait pas, pose un problème. Historiquement constituées de feuillus en majorité, certaines régions (Morvan, Montagne noire, Landes, Dordogne …) ont été profondément modifiées par la plantation de conifères sur 50 à 90% de leurs territoires respectifs induisant ainsi localement des pluies acides.
L’uniformisation des forêts entraîne d’autres problématiques de taille comme le développement des ravageurs ou la propagation des incendies (cas probant du Pin maritime). Outre la perte que cela implique au niveau de la diversité des habitats forestiers (et donc de celle de la biodiversité tout court !), les modes de production actuel ne favorisent aucunement le développement de forêts matures, composées de vieux arbres et d’arbres morts sur pied et au sol, extrêmement favorables à la faune (chiroptères, oiseaux, coléoptères saproxyliques …). De plus, une forêt vieillissante est plus performante qu’une forêt jeune vis-à-vis de ces fonctionnalités biogéochimiques et hydrologiques (rétention du carbone et des eaux de pluie, entretien d’un microclimat, …).
Concernant le climat justement, l’augmentation de la récolte de bois est délétère car on déstocke du carbone. Estampillée écologique, la filière de la production de bois en France brûle de la matière première pour produire de l’énergie. S’ensuit des coupes rases et de la replantation de résineux en masse, le tout soutenu par l’état !
En guise de conclusion
Que ce soit pour l’agriculture ou la sylviculture, il existe un argument ultime à cette folie de la rentabilisation des sols : Il consiste à se flatter de produire des biocarburants plutôt que de réduire notre traffic routier ou aérien. Il faudra également songer à cette idée que, puisque nous sommes de plus en plus nombreux sur terre, comment allons-nous nourrir toute la population humaine si nous dédions ce qu’il reste de nos espaces agricoles et forestiers à la culture d’une énergie soi-disant « verte » ?
Aussi, la biodiversité étant mise à l’écart dans ces processus de production sans lendemain, le verdict qui tombe est sans appel : Il faut notamment savoir que le Royaume-Uni a perdu 97 % de ses prairies abondamment fleuries, 80 % de ses pelouses calcaires, 50 % de ses forêts matures et 40 % de ses landes sauvages (in Moussus J.-P ., 2024) …et la France emboîte largement le pas à nos « amis » d’outre-manche !
Alors plaidons tous ensemble pour la conservation de forêts naturelles sénescentes et pour la diversité des systèmes agropastoraux, riches en biodiversité !


Photos ci-dessus: à gauche, abattage d'arbres à Rémalard-en-Perche dans l'Orne (notez l'arbre creux du premier plan, refuge potentiel pour la faune, définitivement éradiqué), et à droite, coupe rase à Saint-Martin-des-bois dans le Loir-et-Cher (ce mode de gestion industriel et universel de la forêt empêche tout vieillissement des boisements) © Yann Batailhou
À consulter
(Cliquez sur les images pour accéder au document)
La multifonctionnalité de la prairie pour la fourniture de services écosystémiques
Tout savoir sur les fonctions des prairies, un article très instructif par Amiaud B. et Carrère P.
L'essentiel sur la haie
Une plaquette instructive sur la haie et ses multiples fonctions
https://www.ofb.gouv.fr/haies-et-bocages-des-reservoirs-de-biodiversite
Les arbres morts sont des oasis de biodiversité
Renseignez-vous avant d'éliminer un arbre mort sur pied ou au sol : il s'agit d'un véritable écosystème à lui tout seul !
Ahurissant ! Un exemple d'arrachage de haie dans le Parc naturel régional du Perche
Avec l'argumentaire d'un agriculteur concerné par la manoeuvre qui se dit capable de "replanter à l'identique" un haie centenaire ...
Les impacts de la populiculture sur les oiseaux des vallées alluviales
Un essai sur les conséquences de la sylviculture déraisonnée parut dans Ornithomedia
Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire (tome 4, volume 1)
Un document traitant des habitats agropastoraux d'intérêt communautaire qui vous permettra de vous faire une idée sur l'étendue de la diversité des milieux naturels ou semi-naturels agricoles
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome4_1.pdf
Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire (tome 4, volume 2)
Un document traitant des habitats agropastoraux d'intérêt communautaire qui vous permettra de vous faire une idée sur l'étendue de la diversité des milieux naturels ou semi-naturels agricoles
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome4_2.pdf
Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire (tome 1, volumes 1 et 2)
Un document traitant des habitats forestiers d'intérêt communautaire qui vous permettra de vous faire une idée sur l'étendue de la diversité de ces milieux
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome1.pdf